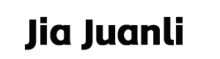LA RECHERCHE DE VIEUX REVES
à propos de l’art de JIA JUANLI
FENG Boyi
Présenter la condition de la création artistique des femmes contemporaines après la réforme et l’ouverture de la Chine ne peut se faire sans souligner et prendre en considération l’art de peindre de JIA Juanli. Je me souviens que déjà en 1988, le monde artistique chinois avait accordé une grande importance à son œuvre.
En effet, lors de la première grande exposition de peinture à l’huile de la Chine, organisée par le Conseil artistique de la Peinture et L’Association des Artistes Chinois, un accueil triomphal a été réservé au portrait de « Qiu Jin » par JIA Juanli, présenté au Centre des Expositions de Shanghai. Or dans l’éducation traditionnelle et officielle de notre génération, Qiu Jin est perçue comme une révolutionnaire de l’époque. Et la photo historique la représentant un poignard à la main, est l’unique source visuelle directe dont nous disposons pour la connaître. JIA Juanli, quant à elle, la dépeint sous les traits d’une jeune fille de famille, cultivée, élégante, intelligente, belle, dépourvue des attributs de la guerrière ou de la femme martyre ; tout comme les autres portraits qu’elle peindra par la suite, ce tableau m’a fait forte impression, et selon, JIA Juanli nous dévoile ici un autre aspect de la personnalité de Qiu Jin : une femme douce et tendre. En passant sous silence le contexte social et historique de Qiu Jin, JIA Juanli nous dépeint la nature de cette femme révolutionnaire telle qu’elle se l’imagine.
Lorsque nous nous sommes mieux connus, j’ai demandé à JIA Juanli ce qui l’avait motivée pour créer cette peinture. Voici sa réponse : « Quand j’ai terminé cette œuvre, je ne lui ai pas donné de titre. En vue de l’exposition, c’est LI Huiang, responsable de l’Association des Artistes de Guizhou qui l’a fait à ma place, mais sans intention particulière.»
Je fus très étonné par cette réponse, car à cette époque, ce genre d’exposition officielle était une occasion exceptionnelle pour un artiste de présenter ses œuvres ; ainsi, pour pouvoir y participer, les artistes de tous le pays se creusaient la tête, en particulier pour trouver le sujet de l’œuvre qu’ils allaient présenter et se conformer aux normes et standards artistiques imposés par les autorités chinoises. A travers les propos qu’elle m’a tenus, il est évident que JIA Juanli ne se soucie pas des évènements de l’actualité ; ce n’est pas une artiste sensible aux directives du système ou de la mode officielle, bien au contraire, elle recherche une espèce de spiritualité pure à travers son goût pour la quiétude et la tranquillité des « corridors de femmes » tels qu’ils sont représentés dans l’art traditionnel. Dans son art, dans son attitude, dans son mode de vie, JIA Juanli aspire et parvient créer un style unique et personnel auquel elle reste attachée. D’ailleurs, depuis les objets anciens qu’elle collectionne, jusqu’à son amour pour les plantes, tout concourt pour refléter l’intimité de son être ; et elle fait fi de toute contrainte extérieure politique ou sociale, de toute pression médiatique pour conserver intacte son indépendance pour ses créations.
Aucun signe, aucune réflexion sur les dérives politiques, aucune allusion sur les problèmes de société, aucune trace de discours sur l’art dans l’œuvre de JIA Juanli, à l’inverse de ce que l’on trouve habituellement chez les artistes chinois contemporains.
Son talent artistique est issu d’une réflexion sur les formes de la peinture traditionnelle chinoise et de la peinture à l’huile. Elle puise dans les traditions ancestrales et culturelles chinoises, des scènes et des situations directement liées à la condition des femmes. Lorsqu’elle représente la femme, point de grands effets narratifs ni d’allusions aux murmures chuchotés en privé, mais une recherche toute en délicatesse, en élégance, teintée de souvenirs et de vieux rêves. Sans l’effet de mode, contrairement à l’art d’avant-garde qui met l’accent sur la force visuelle, les œuvres de JIA Juanli dégagent une sensation de quiétude et d’éternité et nous y percevons les qualités vertueuses des femmes sous un autre aspect, en dehors de l’histoire, en dehors du temps et bien loin de l’actualité.
Bien qu’elle ait déménagé à Beijing dans les années 90 et réside à Paris depuis 1996, il semble que JIA Juanli n’ait pas subi l’influence d’autres cultures ; au contraire, elle s’efforce toujours de découvrir la face cachée des choses. Elle exprime, dans un style délicat, voire plaintif, la pudeur et les désirs de la vie des femmes d’antan. Il semble qu’elle n’ait de cesse que de suivre son cœur et sa nature et se laisser guider par ses sentiments et sa volonté, et rien que cela !
Si nous incluons le travail de JIA Juanli dans le système actuel de l’art contemporain chinois, il est- évident qu’il s’inscrit naturellement dans l’histoire traditionnelle des beaux-arts. Autrefois, les scènes représentant les femmes chinoises se limitaient à un espace clos, les femmes ne sortant jamais de cet espace confiné. Cette expérience de vie de recluse, réservée uniquement aux femmes, contribuait au développement exacerbé de leur personnalité, tant sur le plan affectif que psychologique. Sentiments de solitude, d’ennui, besoins affectifs réprimés …
Nombre de femmes de talent, ayant un penchant inébranlable pour les fleurs, les oiseaux, les arbres et les pavillons, ont décrit dans leurs poèmes et leurs peintures, la vie qui se déroulait dans les « chambres des femmes » et les « résidences royales ». Leur style soigné et raffiné tout comme l’utilisation de teintes soutenues et des nuances plus claires donnent l’image d’une nature riche, belle, réservée et élégante, en conformité avec l’éducation reçue par les jeunes filles de famille cultivée. Les objets, symbole des besoins de l’esprit, nous offrent un aperçu visuel des émotions intimes des femmes de l’époque.
Mais, en 1919, le mouvement de la Nouvelle Culture sonne le glas de la peinture traditionnelle représentant les femmes chinoises. Le principal mot d’ordre est d’utiliser le pinceau pour exprimer la recherche de l’égalité et de la liberté. Il s’agit de réprimer le désir de maternité, prôner l’égalité sexuelle, dénoncer les inégalités sociales.
Et dès la fondation de la Chine Nouvelle en 1949, la société met l’accent sur l’égalité entre les hommes et les femmes, ce qui conduit à la quasi disparition des spécificités artistiques propres à l’art féminin.
A partir de la transformation sociale de la Chine dans les années 80 au siècle dernier, grâce à une plus grande humanité et à une relative liberté de pensée, on assiste au réveil de la conscience des femmes.
Et puis, suite à la Révolution culturelle, pour les artistes masculins et féminins le sujet de prédilection devient la prise de conscience vers plus d’humanité. Cependant, c’est à travers leurs idées personnelles, leurs sentiments et leurs expériences, qu’ils révèlent l’hypocrisie de l’autorité paternelle sous l’ère du pouvoir absolu.
Depuis les années 90, la Chine subit l’influence du mouvement féministe en occident ; Une place bien plus large est accordée aux femmes pour leur permettre de s’exprimer surtout dans les milieux urbains. Et l’art des femmes atteint une relative maturité.
Les difficultés rencontrées par les féministes de l’occident pour relever les défis liés à la somatisation et à l’intimisme vont bien entendu, également concerner les femmes artistes chinoises. Les femmes artistes refusent désormais de se contenter d’adopter une attitude passive et d’éluder les problèmes liés à la condition des femmes. Aussi bien dans l’esprit de création que dans le choix des média, les changements sont évidents et se manifestent sous divers aspects :
– tout d’abord, la nature réelle des femmes : cette nature se révèle au travers des circonstances de la vie, de la maladie, de l’obsession et des chagrins, etc. propres à la gent féminine. La complexité et la diversité de ces symptômes trouvent leur écho dans les modes d’expression artistiques, ce que l’on rencontre très rarement dans les œuvres des artistes masculins d’autrefois.
– Ensuite l’expression des sentiments : Il s’agit pour l’artiste de choisir un cadre ou un objet qui reflète les sentiments éprouvés par un personnage et accentuer ces derniers par le biais de l’émotion qu’il aura lui-même perçue et analysée. Ainsi la fusion de la sensibilité personnelle et de l’impression générale suscitée par le paysage vont consciemment ou inconsciemment imprégner l’œuvre créée. Notons cependant que pendant la phase de création, le caractère intrinsèque des paysages ou des objets est souvent négligé par la femme. En effet, la femme n’emprunte que les points nodaux correspondant à ses propres expériences physiques et spirituelles et s’attache davantage à ses sentiments intimes. Elle accorde ainsi plus d’importance à la satisfaction personnelle ; elle jouit de plus, d’une certaine aisance dans le processus de création ; ce qui explique son caractère presque égocentrique et solitaire. De ce fait, entre la femme artiste et son œuvre, la frontière se révèle être imprécise et mystérieuse, la distance ténue.
– Troisièmement, la fin de la loi du silence et l’incitation à avancer à pas feutrés : Du fait de la corrélation irrationnelle entre les expériences physiques et spirituelles propres à la subtilité des sentiments, les travaux des femmes artistes ne suscitent pas à première vue une interprétation précise. Il semble que leurs œuvres soient empreintes d’une certaine réserve et porteuses de messages simplistes ; il n’en est rien. En fait, à travers des cadres des plus imprévisibles, elles renferment des discours subversifs et incitatifs allant jusqu’à l’expression d’une folie secrète et une critique féroce. Dans ce style de peinture, dérivée de l’instinct féminin, l’utilisation d’un langage discret destiné à colporter des informations sous jacentes éveille la conscience personnelle et inverse les normes et le standards de vertu dictés aux femmes élevées dans la tradition.
– Et enfin, la capacité créative artistique des femmes contemporaines : A travers cette expérience particulière qu’elles on vécue, et leur désir de faire concurrence aux hommes dans le milieu artistique, les femmes s’expriment sur leur propre condition sous un angle de vision spécifiquement féminin. Le mode narratif qu’elles utilisent tient de la prouesse lorsqu’il s’agit de maîtriser les règles du jeu de la société commerciale. Elles pénètrent le monde intime le plus profond des femmes et n’hésitent pas à exposer en public les sujets tabous de jadis afin de susciter un débat. Exposer au public l’art des femmes devient à la mode.
Ce que l’on peut retenir du réveil de cette conscience indépendante, c’est que les femmes jusqu’alors « cachées » et « muettes » et dont la création artistique ne demandait qu’à «s’exprimer » autrefois, parviennent graduellement à « auto-s’exprimer » et à « parler de leur propre initiative ». Ainsi, on peut affirmer qu’en l’espace de 30 ans, l’art des femmes chinoises a parcouru le chemin que les féministes de l’occident ont mis presque un siècle à traverser.
JIA Juanli a en quelque sorte adopté une attitude rétrospective dans sa création : En partant de la condition des femmes d’après les sources culturelles traditionnelles, elle exprime la nostalgie d’un espace de rêve déjà lointain. Au travers de ce qui vient d’être expliqué, JIA Juanli est probablement la représentante parfaite des artistes de la deuxième catégorie. Grâce à sa maîtrise parfaite de la peinture à l’huile, sa manie du « fétichisme », et sa passion pour les détails apparemment insignifiants de la vie de l’époque, elle réussit à formuler avec talent la condition de vie des femmes d’antan. Et il semble que les couloirs, les résidences royales, les palais, les lits, les paravents, etc. sont toujours les sujets de prédilection de son œuvre picturale. Depuis ces paysages confinés jusqu’ aux attitudes et les gestes, il est incontestable que JIA Juanli est éprise de l’ombre des vieux rêves, et il serait même plus exact de dire qu’elle dessine les émotions qu’elle ressent dans sa vie à elle. Car l’idéologie qui ressort de ses peintures porte la marque du passé, mais elle y ajoute des effets accentués d’abstraction floue. Tous les personnages présents dans sa peinture sont sans aucun doute ancrés dans « le passé », et tout comme la nature inhérente au passé, ils revêtent la douceur et la tranquillité du passé. Cependant, les couleurs et les touches spécifiques enveloppent les scènes, et c’est là l’essentiel de ce qui ressort de ses huiles. Bien que n’exprimant pas de manière simple et directe la complexité de la réalité, c’est par cette touche même qu’elle achève ses créations. Elle se tient loin de la réalité, ce qui lui permet de conserver les détails de ses réflexions et émotions et de nous faire apprécier la qualité et le mystère du langage de la peinture à l’huile. La contemplation de ces œuvres nous le témoigne. Elle emprunte les morceaux de vie des femmes d’antan et les rapportent à sa vie réelle ; ces pans de vie l’aident à laisser vagabonder ses souvenirs et ses rêves. Les images de ces femmes, comme les silhouettes sur la soie, créent un effet de décalage puis de superposition. Dans cette ambiance nostalgique et mélancolique, elle recherche la liberté et l’inspiration par le rêve et révèle un style beau mais triste. De ce point de vue, elle est très réaliste, elle présente de façon concrète le monde intime tel qu’il se présente dans son imagination, une réalité abstraite, reflet de son propre état d’esprit. Sa passion pour ce style de langage remplace même son intérêt pour les objets qu’elle peint dans ses œuvres. Ainsi, son travail se concentre sur la construction d’un palais délicat et chimérique. Tout comme MENG Hui, qui, dans son livre “Seize chansons en fleurs” (MENG Hui, Édition Sanlian, septembre 2009), choisit seize fragments de la vie des femmes d’autrefois et les assemblent afin de présenter un tableau coloré de la vie des femmes d’antan, pour ensuite tenter de recréer les jolis détails dans l’histoire. Ce sont ces détails qui font ressortir le charme des femmes de jadis et qui nous permettent d’appréhender directement les nuances des fils qui tissent l’histoire de leur vie.
Quant aux autres œuvres, du fait que l’artiste maîtrise à la perfection la technique du rapprochement des couleurs analogiques, elles reflètent indirectement les expériences personnelles de JIA Juanli, ainsi que ses souvenirs et ses intérêts. Il est évident que JIA Juanli réussit à crée une structure vivante de qualité grâce au mélange des couleurs. L’arrière-plan est souvent constitué de forêts ou d’espaces vides situés en bordure des forêts où les arbres se repoussent noircissant ainsi toutes les feuilles vertes. Ca et là, des fleurs, des lotus, des branches, des oiseaux et des grues s’y retrouvent comme sur des nuages. Ce type d’arrière-plan donne une atmosphère mystérieuse teintée de mélancolie, prémices pour la qualité du fond. Elle bouleverse intentionnellement l’axe de la perception visuelle, fragmentant le champ en plusieurs parties qu’elle peint pour les faire converger dans l’arrière-plan coloré. Elle introduit l’illusion dans la réalité, les fait se heurter, les mélange et parvient à partir de formes distinctes à restituer des images voilées de rêve. C’est cet enchevêtrement entre fantasme et réalisme qui donne au contenu de l’image visuelle du relief et qui contribue à communiquer une impression diffuse. Et puis, elle introduit une ou plusieurs silhouettes féminines vues de dos, qui permettront d’organiser les éléments visuels du rêve afin de faire naître les sensations : sentiment d’identification secrète correspondant à une relation d’interdépendance. Par le biais de cette mystérieuse télépathie, image et réalité se confondent pour le spectateur qui finira par ressentir la tristesse et la mélancolie des personnages féminins.
Aujourd’hui, la femme véritable n’existe plus. Nous vivons aujourd’hui une situation générale tragique, et les femmes en sont les victimes les plus touchées: Il nous est impossible d’échapper au désir, à la solitude, à l’étouffement, à la tristesse, à la mort inexorable qui survient tranquillement à la suite d’une longue attente solitaire et triste. Au sein de cette structure, l’intention de JIA Juanli est de démontrer, que dans ce monde chaotique où les êtres fragiles qui ne parviendront pas à trouver un sens à la trajectoire de leur vie seront engloutis, il y a néanmoins une place pour la conception artistique de qualité pour les femmes qui parviennent à contenir dans la discrétion les émotions qu’elles vivent malgré l’oppression intense. Les œuvres de JIA Juanli relatent non seulement les expériences de vie concrètes vécues par les femmes, mais sont conçues pour transmettre un message à l’intention des femmes. Dans son travail, JIA Juanli adopte une totale liberté de création. Elle intègre toutes sortes de situation et nous présente une palette de sentiments – ses sentiments intimes – tels une valeur sentimentale ajoutée, révélant son attitude personnelle – ne pas dramatiser – et son talent inégalé dans ce monde chaotique et bruyant. En effet, il n’est pas difficile d’exprimer ses sentiments, et c’est là ce qui représente pour elle le plus d’intérêt : ceci explique l’engouement de JIA Juanli pour le mode de vie et la morale des régions au sud du fleuve Yangtsé. Cette attirance, elle la porte dans ses gènes, et contribue au langage et la forme de sa peinture en plein cœur de l’ère de la mondialisation et d’internet dans lequel nous vivons. Sans aucun doute, selon les critères de l’esthétique traditionnelle chinoise, sa peinture peut être considérée comme représentant une métaphore de la philosophie des lettrés dans la tradition chinoise, et également comme une réflexion profonde sur l’existence, une image et un signe de vie.
JIA Juanli raconte dans son œuvre picturale le rêve des lettrés et leur vie d’ermite, et exprime avec naturel un jugement esthétique sensible et délicat propre aux femmes. La pureté inhérente à son caractère «compense » l’impatience de l’actualité. Son goût esthétique se développe en particulier et constitue des paroles fleuries esthétisantes tout en étant le reflet de sa propre expérience. Elle manifeste sans scrupule son engouement pour les scènes de la vie quotidienne de nos ancêtres telles qu’elle se les imagine, et les peint fidèlement; et cette profondeur ainsi que cette mélancolie accentuent aisément la poésie du tableau. A travers ses peintures, JIA Juanli nous fait aimer les cours intérieures, l’intimité du lieu de vie des femmes, les paysages, les fleurs, les tables et les échiquiers. Elle dépeint avec discrétion, ces attitudes tranquilles, indolentes, désinvoltes, généreuses, voire étouffantes et décadentes. Il semble que ce soit là l’expression de la nostalgie de la sentimentalité et le regret des lettrés chinois face à la culture actuelle de la Chine. Bien qu’il n’y ait plus place dans la région du fleuve Qinhuai et dans les régions au sud du fleuve Yangtsé pour vivre la douceur onirique le mode de vie des lettrés d’antan et ceux d’aujourd’hui ne sont pas comparables. Ceci étant, dans ses tableaux elle a le souci d’exprimer une certaine liberté perceptible dans un univers clos dans la mesure où le sujet est créé et transmis par les lettrés eux-mêmes. Notons que JIA Juanli combine le goût esthétique des lettrés d’autrefois et celui des femmes elles-mêmes. Bien entendu, ce que j’expose ici, n’est que le reflet de mes sentiments et de mon interprétation personnelle des peintures de JIA Juanli ou d’après ce que je connais d’elle depuis de nombreuses années. Il est possible que cela ne corresponde pas à sa propre motivation créative, comme lorsque par le passé, j’avais eu une interprétation erronée se son tableau « Qiu Jin ».
Néanmoins, il y a toujours un décalage entre la conception subjective de la création artistique et l’impact de l’œuvre sur le spectateur surtout lorsque cette œuvre, en tant que produit culturel dont l’effet sur la société est critiqué, n’est pas en harmonie avec l’auteur. Comme le dit l’historien d’art Panovsky, il est évident que l’interprétation d’une œuvre surpasse la conception personnelle de l’auteur. Il est difficile de faire remonter l’histoire à ses origines et avec le temps, les scènes réelles sont ensevelies pour toujours dans les poussières du passé. Aujourd’hui, les textes laissés par l’histoire offrent un espace d’interprétation sans limites. Et celui-ci se transforme en de beaux rêves nostalgiques et exaltants, tout comme l’éblouissement jaillit sous les pinceaux de JIA Juanli, et de l’imagination des spectateurs qui s’arrêtent devant ses tableaux. Heureusement, nous ne sommes pas tous des spécialistes de l’histoire de l’art, ni de l’archéologie. La nostalgie ne consiste pas à revenir sur des scènes culturelles historiques telles que nous les imaginons, mais de réfléchir à la poursuite d’une tradition culturelle temporelle tendant à la paix et à la perfection, de ressentir le charme du classicisme chinois dans sa réalité imparfaite, de pénétrer le vieux rêve d’une noble spiritualité et d’en reproduire toute la quintessence. Parce que l’histoire, la réalité et le ressenti personnel sont plus complexes et subtils que nous ne l’imaginons et comprenons.